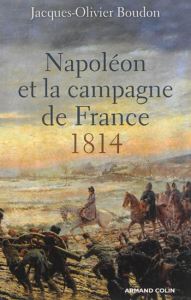Editeur : Philippe Rey (7 octobre 2010)
Collection : DOCUMENT
Langue : Français
ISBN-10: 2848761709
ISBN-13: 978-2848761701
Dimensions : 15 x 12,8 x 1,8 cm
Russies
Dominique Fernandez, académicien français de grande renommée, ne cesse d’arpenter la Russie, de Moscou à Vladivostok et de Saint-Pétersbourg à Irkoutsk. Il le fait en amoureux fou de cet immense espace, trente fois grand comme la France. Il sillonne donc la Russie en tous sens, à la recherche de l’âme russe. Elle se niche partout, dans le paysage, dans la religion, les comportements et les mentalités. Un de ses traits saillants est par exemple cette étrange capacité à la résignation, au fatalisme, le fatum des Anciens. A quoi est-elle due ? se demande l’auteur : « A l’influence de l’esprit oriental », au « fait d’habiter un pays sujet à des différences si énormes entre le chaud et le froid, à des sautes de températures si brusques qu’elle réduisent à néant tout essai de résistance, à l’habitude ancestrale […] d’être soumis à un pouvoir écrasant. » (p. 111)
L’auteur n’oublie pas de raconter la Russie de Vladimir Poutine. Elle n’a pas, sous sa plume, les traits mauvais que lui prête un Bernard-Henri Lévy. Même s’il reconnaît volontiers à Vladimir Poutine ses traits d’autorité, Dominique Fernandez ne lui en tient pas rancune : Poutine n’incarne-t-il pas une autre face de l’âme russe à travers la recherche de la puissance et l’aspiration à l’énergie, que l’on trouve depuis longtemps chez les héros et les artistes ?
Le livre de Dominique Fernandez est magnifiquement écrit. On ne le referme pas sans le désir d’en savoir plus, de chercher, à notre tour, ce qu’a de merveilleux et de tragique cette âme russe, une âme faite de fatalisme, espérant sans cesse en des lendemains meilleurs. « Ce n’est pas la misère qui caractérise la Russie ou qui l’a jamais caractérisée. C’est le sentiment tragique de la vie. La tragédie peut provenir de la misère. Mais la misère n’a été qu’une composante parmi d’autres plus graves, plus constantes : la violence historique, la violence climatique. » (p. 186).
Elles sont belles les Russies de Dominique Fernandez, avec ses paysages monotones, ses villages perdus aux maisons déglinguées et aux jardinets minables, ces ciels plombés. Un très beau livre d’amour !
Dominique Fernandez, Russies, Philippe Rey, 2014, 204 pages, 18 €