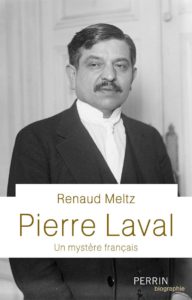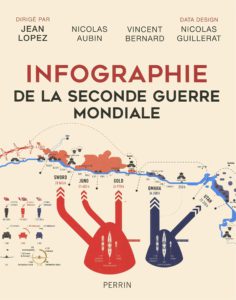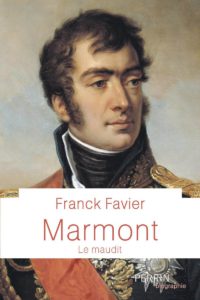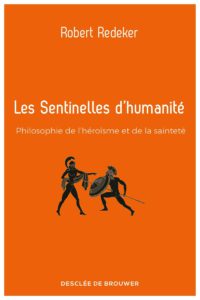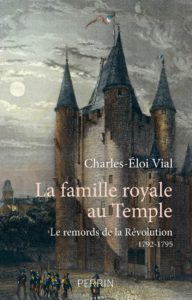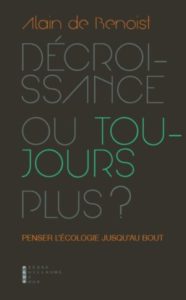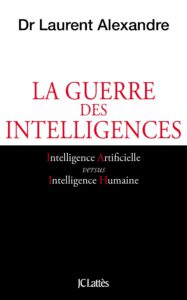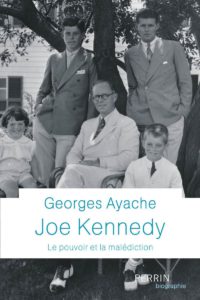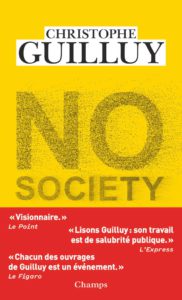
Editeur : FLAMMARION
Collection : Champs actuel
Langue : Français
ISBN-10 : 2081451808
ISBN-13 : 978-2081451803
Dimensions : 11 x 1,2 x 17,7 cm
Un livre signé Christophe Guilluy est toujours un événement. La réflexion de fond ne change pas : à côté des grandes métropoles, à l’aise dans le bain de la mondialisation, la France périphérique tente vaille que vaille de tirer son épingle du jeu. Cette France des petites villes et du monde rural, c’est aussi la France populaire et celle des classes moyennes. Alors que notre pays a tant de mal à faire société, que le communautarisme menace, que des pans entiers du territoire se trouvent en voie de délitement, le bon sens voudrait que l’on choie la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que c’est la classe modèle, celle que regardent ceux qui veulent s’intégrer. Or, « en détruisant économiquement et culturellement l’ancienne classe moyenne occidentale, et notamment son socle populaire, la classe dominante a créé les conditions de l’explosion des sociétés occidentales » (p. 82) C’est l’existence de la classe moyenne qui peut pousser le nouvel arrivant à adopter des codes et une posture qui lui sont naturellement étrangères. Une société se trouve en capacité d’intégrer dans la mesure où elle est portée par un modèle culturel dominant. Le mépris des classes privilégiées pour les classes populaire et moyenne risque de signer la disparition progressive du bien commun. Décapant !
Christophe Guilluy, No society, Flammarion, 2018, 242 pages, 18€
L’extrait : “Ce mépris des nouvelles classes dominantes et supérieures pour leur propre peuple est à l’origine de l’éclatement des sociétés. » (p. 85)