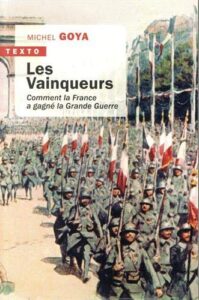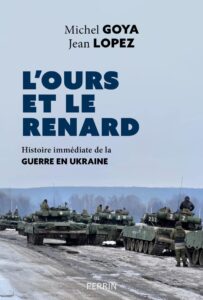
Langue : Français
Broché : 300 pages
ISBN-10 : 2262105103
ISBN-13 : 978-2262105105
Poids de l’article : 330 g
Dimensions : 13.7 x 2.5 x 20.2 cm
Il est difficile de se faire une idée de ce qu’il se passe actuellement en Ukraine. Les Ukrainiens vont-ils parvenir à réoccuper les oblasts de Donetsk et de Louhansk ? Quant à l’armée russe, va-t-elle réussir à parer la contre-offensive ukrainienne, peut-être à repasser à l’offensive ? Quelles sont les pertes des uns et des autres ? etc. Bref, nous sommes dans le brouillard et les médias ne font rien pour nous éclairer de façon satisfaisante. Par exemple, il y a un gouffre entre les analyses dispensées par un Xavier Moreau (pro-russe) de celles délivrés par Xavier Tytelman (pro-ukrainien). L’ours et le renard, écrit par deux spécialistes, tombe à point nommé pour que l’on se fasse l’idée la moins inexacte du conflit. Les auteurs, qui s’intéressent essentiellement à l’aspect purement militaire du conflit, concluent qu’à l’heure actuelle bien malin est celui capable de dire qui, à la longue, l’emportera et il n’est pas impossible que le front se fige pour un certain temps, les adversaires étant englués dans leurs difficultés respectives.
Michel Goya & Jean Lopez, L’ours et le renard, Perrin, 2023, 346 pages, 21 €
L’extrait : « Si la plupart des Occidentaux se préparent à une confrontation avec la Russie beaucoup plus sérieuse qu’auparavant, ils ne pensent certainement pas se retrouver face à une guerre de cette ampleur. » (p. 124)